Cap ou pas cap d’assister à une chasse à courre : défi relevé !
Aussitôt publié, aussitôt contactée ! Il n’aura fallu que quelques heures pour que les contacts de mes réseaux sociaux se manifestent pour relever le challenge du « Cap ou pas Cap de découvrir la Chasse à Courre ».
Quel ne fut pas mon étonnement en découvrant les profils si différents intéressés par cet appel à la découverte : chasseurs, non chasseurs, jeunes, bien moins jeunes, hommes, femmes …. En résumé, le reflet de la belle mixité de notre passion.
Baptiste, 25 ans, a souhaité faire le bois pour faire « la totale » ; c’est avec beaucoup de curiosité qu’il était posté à 6h30 au lever du jour, en observation, qu’il a découvert le laisser courre, les ruses de notre cerf, le récrie des chiens, l’allure de nos chevaux athlétiques. Ce jeune complètement conquis est revenu 2 autres fois, en forêt d’Amboise, en vélo cette fois ci ; il se réjouit déjà d’être à la saison prochaine !
Sophie, 35 ans, passionnée de nature et d’animaux, ayant découvert la chasse à tir cette année, a souhaité continuer dans sa lancée et venir constater par elle-même ce qui pouvait bien animer autant les veneurs.
Une première chasse pour Sophie le 19 février en forêt d’Amboise, en voiture, et dès la semaine suivante elle attaquait les cours d’équitation pour être à cheval la saison prochaine !
Le challenge a également été brillamment relevé par Noémie, 35 ans, amoureuse de chiens qui a voulu connaître tout simplement en quoi consistait la chasse à courre. La simple curiosité initiale a rapidement laissé place à un émerveillement certain : « Je me couche ce soir avec des étoiles plein les yeux. Le retour aux sources. Beauté tout simplement. » La prochaine fois, Noémie compte bien être en vélo, pour être au plus proche de la nature et du travail des chiens.
Il en fut de même pour Patrick et Marc qui ont adoré leur journée découverte et se sentent maintenant bien plus armés pour contredire les détracteurs de notre passion.
Toutes les questions, plus pertinentes les unes que les autres que nos invités ont posées sur ces 3 journées de « Cap ou pas Cap » m’ont également permise de prendre du recul et de me remettre à l’esprit à quel point nous avons de la chance de pratiquer une chasse aussi belle, écologique et pleine de valeurs !
L’immense majorité des personnes ayant répondu « Oui » à la question de l’abolition de la chasse à courre l’a fait par pure méconnaissance, ou pire encore, par connaissance de toutes les désinformations qui oppressent l’avis général. En effet, « le plus grand ennemi de la connaissance n’est pas l’ignorance mais plutôt l’illusion de la connaissance » et Il est ainsi de notre devoir, de notre responsabilité de faire connaitre la vènerie. Nous sommes 10 000 pratiquants, 100 000 sympathisants, alors imaginez un peu le rayonnement si chacun de nous amenait à la saison prochaine des Baptiste, Sophie ou Noémie, qui eux même parleraient positivement de leur découverte du week-end à au moins 10 personnes !
Alors serez-vous « Cap » de faire vous aussi relever le challenge du « Cap ou pas Cap » à vos amis et faire rayonner les valeurs positives de la Vènerie ?


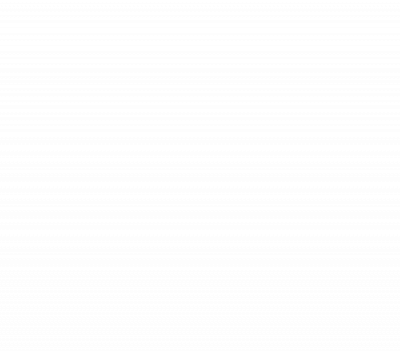
 Les 10 et 12 octobre 20
Les 10 et 12 octobre 20
